Les violons occidentaux pendant que Haïti se défait

Par le Comité de rédaction
Le 18 mai 2023 à 14 h 44 HAE
Il y a près de 30 ans, alors qu’il siégeait au Sénat, Joe Biden a déclaré à un intervieweur que « si Haïti sombrait tranquillement dans les Caraïbes, ou se relevait de 300 pieds, nos intérêts n’auraient pas beaucoup d’importance ». Maintenant, en tant que président, M. Biden a élaboré une politique — ou l’absence d’une politique — qui reflète cette indifférence. Il l’a fait alors même qu’Haïti, le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental, est saisi par sa pire crise sécuritaire, politique et humanitaire depuis des décennies, que les Nations Unies ont récemment assimilée à la guerre.
Le gouvernement inefficace d’Haïti a demandé une intervention internationale. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a lancé à plusieurs reprises des appels urgents en faveur d’une force armée spécialisée pour endiguer la violence, rétablir un semblant d’État de droit et établir les conditions pour la tenue d’élections, qui sont impossibles dans l’anarchie actuelle. La communauté internationale a réagi en haussant les épaules.
Haïti est un État en déroute dont l’effondrement, accéléré par l’assassinat non résolu de son président il y a près de deux ans, a généré des dizaines de milliers de migrants désespérés d’atteindre les États-Unis. En l’absence d’un gouvernement fonctionnel, et face à une police nationale en décrépitude dont les membres sont abattus dans les rues, les gangs ont organisé une émeute sur la capitale, Port-au-Prince, et ailleurs.
Le nombre de meurtres, de viols et d’enlèvements a grimpé en flèche. La violence de rue est omniprésente et les enfants sont souvent parmi les victimes. Des armes et des munitions sophistiquées de haut calibre, dont une grande partie provenaient des États-Unis, ont alimenté la spirale du chaos. Le trafic de drogue a explosé. Récemment, le vide dans l’autorité gouvernementale a donné lieu à la violence des justiciers contre les membres présumés de gangs, dont certains ont été abattus et brûlés dans la rue.
Dans un pays qui a longtemps lutté pour se nourrir, les retombées humanitaires du pandémonium sont cataclysmiques. Dans un récent rapport, l’ONU a qualifié la vie en Haïti de « lutte quotidienne et terrifiante pour la survie ». Sur une population d’environ 12 millions d’habitants, près de 5 millions de personnes ont du mal à se nourrir et près du tiers des Haïtiens vivent avec moins de 2,15 dollars par jour.
L’administration Biden, qui cherche à empêcher les Haïtiens qui se rendent au Mexique de traverser illégalement la frontière américaine, a établi un soi-disant programme de libération conditionnelle humanitaire. En vertu de ses dispositions, les résidents des États-Unis qui répondent à certains critères peuvent demander à parrainer un immigrant haïtien pour entrer légalement au pays pendant une période limitée. Mais le programme a été miné par la désinformation et les problèmes techniques. De nombreux haïtiens qui ont réussi à l’utiliser sont des professionnels de santé, dont l’exode a contribué à la détérioration de la santé publique du pays.
La longue et mouvementée histoire d’interventions internationales d’Haïti a amené à juste titre les sceptiques à l’intérieur de la nation et ailleurs à se méfier d’un nouvel effort de la part des étrangers pour mettre de l’ordre. Les Marines américains ont construit des infrastructures en Haïti au cours d’une intervention d’environ deux décennies au début du XXe siècle, mais ils se sont également rendus coupables d’un racisme épouvantable. Au cours de ce siècle, les Casques bleus de l’ONU ont atténué la violence politique, mais ils auraient aussi exploité sexuellement et agressé des femmes et des filles haïtiennes. D’autres troupes de l’ONU ont introduit le choléra dans le système d’approvisionnement en eau haïtien en raison d’une mauvaise hygiène à l’une de leurs bases; le résultat a été une épidémie qui a tué quelque 10 000 personnes et en a écoeuré des centaines de milliers.
Malgré ces expériences honteuses, il n’y a pas d’échappatoire plausible à l’effondrement d’Haïti en l’absence d’une intervention internationale. Une large coalition de groupes civils et de partis politiques en Haïti a appelé à un nouveau gouvernement d’unité nationale qui préparerait la voie aux élections. Mais les divisions internes entre ces groupes, et la simple réalité qu’il n’y a pas de force intérieure capable de lutter contre les gangs de rue, ont produit une paralysie politique.
La probabilité d’un tel dysfonctionnement politique n’était que trop apparente au lendemain de l’assassinat du Président haïtien Jovenel Moïse en juillet 2021. Mais l’ampleur de la misère d’Haïti depuis a même dépassé les prévisions les plus sombres.
L’administration Biden et le gouvernement canadien du premier ministre Justin Trudeau ont tous deux refusé d’organiser une intervention armée. La France a de même désapprouvé, malgré son propre rôle dans l’appauvrissement d’Haïti, d’abord par l’exploitation des ressources naturelles haïtiennes en tant que maître colonial au XVIIIe siècle, puis en imposant des réparations forcées qui ont duré plus d’un demi-siècle. L’Organisation des États américains n’a pas non plus manifesté l’intérêt ou la capacité d’organiser une telle intervention.
Le sous-produit de l’apathie impitoyable du monde est douloureux à voir — un pays incapable de se débrouiller tout seul, dans une descente accélérée vers l’agonie.
À propos du Comité de rédaction
Les éditoriaux représentent le point de vue de The Post en tant qu’institution, déterminé par le débat entre les membres du comité de rédaction, basé dans la section Opinions et séparé de la salle de rédaction.
Membres du comité de rédaction et domaines d’intérêt : Rédacteur d’opinion David Shipley; Rédactrice d’opinion adjointe Karen Tumulty; Rédacteur d’opinion adjoint Stephen Stromberg (politique nationale et politique); Lee Hockstader (affaires européennes, basé à Paris); David E. Hoffman (santé publique mondiale); James Hohmann (politique intérieure et politique électorale, y compris la Maison-Blanche, le Congrès et les gouverneurs); Charles Lane (affaires étrangères, sécurité nationale, économie internationale); Heather Long (économie); Ruth Marcus, rédactrice adjointe; Mili Mitra Keith B. Richburg (Affaires étrangères) et Molly Roberts (Technologie et société).
source: The Washington Post
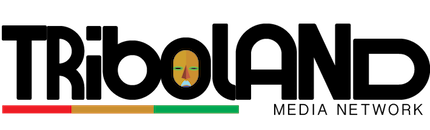
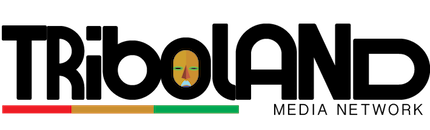

Comments are closed.